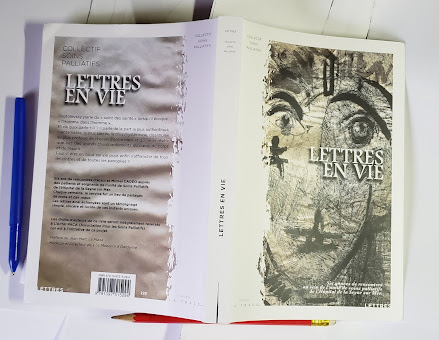Mickaël Carlier entre en 2021 chez Annika Parance Éditeur avec son roman Arides qui cogne dur. Je l’ai croisé en novembre lors du lancement de son livre. J’ai cru bon l’interroger sur ses motivations et vous le présenter. Vous risquez d’entendre parler à nouveau de lui. Merci d’avoir pris le temps d’échanger avec moi. Bonne découverte.
Vous êtes un artiste dans l’âme. Qu’est-ce qui est venu vers vous en premier ? L’écriture, la photographie, le théâtre ?
L’écriture et la photographie sont arrivées plus ou moins au même moment dans ma vie, à l’adolescence. Je griffonnais des paroles de chansons et des débuts d’histoires, et je prenais mes premières photos en noir et blanc, avec le vieil appareil de mon père. Si la qualité de tout cela était alors très relative, l’envie, elle, était bien déjà là : observer et créer. Cette envie ne m’a jamais quitté, mais j’y ai longtemps accordé qu'une attention épisodique. Jusqu’à ce que je me mette sérieusement à l’écriture d’Arides. Cela a été un marathon qui s’est étalé sur près de dix ans, mais je ne lâchais pas mon but : aller au bout de ce manuscrit et tout faire pour être publié.
Quant au théâtre, j’ai pris mes premiers cours vers 18
ans. Ma motivation à l’époque était de vaincre ma timidité! Je voulais oser me
tenir debout face aux autres, parler devant eux, sortir de moi-même : la scène
et le jeu ont donc d’abord été des outils d’émancipation. Ce n’est que par la
suite que j’ai aimé le théâtre pour son territoire artistique. Et c’est en
rejoignant il y a huit ans le Théâtre Libre, une troupe incroyable qui existe
depuis plus de vingt ans et dans laquelle chacun peut écrire, jouer ou mettre
en scène de courtes pièces, que j’ai développé ce goût : j’y ai joué, j’y ai
écrit, j’y ai mis en scène, mes textes ou ceux des autres. C’est aussi au sein
de cette troupe que j’ai pour la première fois osé soumettre des textes, et que
j’ai réalisé que l’écriture faisait vraiment partie de moi.
Qu’avez-vous écrit auparavant ? (matériel édité ou non)
J’ai écrit plusieurs courtes pièces dans le cadre du Théâtre Libre, pièces que l’on joue au Cabaret du Lion d’Or, à Montréal, chaque printemps. Ce sont des textes qui ont en commun d’explorer nos trajectoires de vie, la confusion entre ce que les cadres sociaux ou familiaux nous poussent à faire et ce que l’on veut vraiment faire - ou être - au fond de nous.
Depuis le début de la pandémie, j’ai aussi beaucoup écrit : de courts textes, des poèmes, des nouvelles que je publiais sur Facebook. Un de ces textes issu des confinements a d’ailleurs été retenu pour un ouvrage collectif qui sortira au printemps 2022 aux Éditions du Quartz. J’ai aussi cofondé avec des amis un collectif d’écriture, Mitimacha. Chaque semaine, depuis deux ans et demi, on se retrouve afin de se lire les textes que nous écrivons, nous les commentons, les explorons ensemble. Nous avons produit une dizaine d’épisodes d’un podcast dans lequel on lit certains de ces textes. L’espace bienveillant de création et de partage que nous avons créé est très puissant : il nous permet d’oser plonger dans nos zones d’ombres, dans nos intimités, dans toute la fragilité que peut exiger l’écriture.
Le ralentissement imposé par la pandémie m’a aussi permis de me remettre à la photo de rue : pendant un an, de juillet 2020 à juillet 2021, j’ai pris une photo par jour, principalement dans mon quartier, Rosemont. Cette démarche imposée a d’ailleurs fait germer l’idée d’une nouvelle histoire et servira de trame à un second roman que je suis en train d’écrire.
Quelles furent les prémices d’Arides ?
Les premières scènes que j’ai écrites sont celles du début du livre : ce type colossal qui vient se perdre dans cette région désertique, à la recherche d’un village. Voilà ce qui est sorti, mais je n’avais aucune idée de qui était cet homme, ni ce qu’il cherchait. Les prémices ont été très longtemps inconscientes : il y avait une quête, une confrontation avec un territoire et des personnages hostiles. Il y avait la dureté. Les prémices étaient donc de l’ordre du ressenti, de l’élan, de la lutte personnelle. L’histoire elle-même, concrète, avec ses personnages, ses tenants et aboutissants, a mis longtemps à se préciser dans mon esprit. Et puis j’ai fini par comprendre que ce que j’écrivais était une histoire de famille et de legs. J’ai pu alors travailler sur la construction à proprement parler de cette histoire et de cette famille. Le conscient de l’écriture a pris le relais pour peaufiner ce que l’inconscient avait commencé à produire.
Dans ce roman, on est dans le midi de la France, tout comme on pourrait être en Italie ou dans le sud des États-Unis ? Comment avez-vous songé au village déserté ?
Il est important de préciser qu’il n’y a aucune indication dans le roman sur le lieu où se déroule l’histoire : le lecteur peut y voir le sud de la France, l’Italie ou la Grèce, l’Amérique profonde…, ce sera son interprétation ! Et c’est voulu : le personnage, Dan, se perd totalement, autant sur le plan géographique qu’émotionnel, je voulais plonger le lecteur dans cet état de confusion. C’est pourquoi le lieu est indéfini : je ne voulais pas que le lecteur puisse se raccrocher au moindre repère réel, à une région qu’il connait et qui aurait pu le «rassurer». Non, le gars est vraiment perdu, et le lecteur doit se laisser aller avec lui.
Quant au village abandonné, pour moi l’image est puissante : elle évoque tout ce qui est révolu, toutes ces vies qui ont existé et dont il ne reste à peu près rien. Ces maisons ont été les témoins de familles, d’amours, de naissances, de décès : ce quotidien a fini par disparaître, comme le nôtre disparaitra. Cela parle de toutes ces vies qui nous ont précédés et dont chacun de nous est issu. Ces lignées sans fin me fascinent. On sait si peu de choses sur ceux qui ont vécu avant nous. Le village abandonné, c’est le symbole de cette connaissance extrêmement ténue que la plupart de nous avons de nos familles et de nos aïeux.
Vous avez mis en place deux personnages qui déplacent de l’air, Dan et Élina, qui sont en quête de survie. Qu’en pensez-vous ?
Dan et Élina sont très différents : lui est un quinquagénaire rustre et bagarreur, elle une jeune femme éthérée aux airs de chamane - deux extrémités dont les trajectoires vont être amenées à se croiser. Tous deux cherchent effectivement à survivre face à une vie qui les a malmenés. C’est d’ailleurs le point commun de la plupart des personnages d’Arides : ils s’évertuent à exister, à être vus, entendus, pour ce qu’ils sont véritablement, quitte à se débattre. D’où cette violence quasi permanente, latente ou réelle : il leur faut rompre les liens, frapper avec rage, se venger des blessures du passé. Ce sont leurs façons, brutales, maladroites, de dire qu’ils existent. J’aime dire qu’Arides est un roman empli d’amour, et de manques d’amour. C’est ce qui anime les personnages - c’est aussi ce qui nous anime, chacun d’entre nous. Nos violences, petites ou grandes, nos duretés, nos fermetures face aux autres ne sont-elles pas issues de nos carences d’enfants ? Les personnages d’Arides ne disent finalement rien d’autre que « j’existe et j’ai besoin d’amour ».
Peut-on qualifier ce roman de plaidoyer pour la paternité ?
Non, ce n’est pas un plaidoyer mais plutôt un regard sur une forme, que j’aimerais croire d’une autre époque, de paternité : dure, silencieuse, autoritaire, coupée de ses émotions. Les pères d’Arides sont pris avec leurs douleurs, le poids de leur propre enfance. Ils ne parviennent pas à «corriger le tir» et lèguent leurs manques à leurs enfants. S’il devait être un plaidoyer, Arides en serait un pour une paternité émancipée du masculinisme rigide et froid dont ont été issus beaucoup des pères qui nous précèdent.
Quel personnage vous ressemble le plus ? Et pourquoi ?
Mes personnages sont composites, et j’y ai insufflé diverses parties de moi. Assurément, je suis un peu Dan, qui cherche à comprendre ses origines - pas tant biologiques, mais celles d’un comportement mortifère, ces silences qui sclérosent une famille et brident l’épanouissement. Je suis un peu Edouard qui tient tête à son père, jusqu’à prendre des décisions lourdes de conséquences. Je suis aussi un peu Hugues qui pose un regard doux et bienveillant sur sa fille en train de devenir femme. Tout au long d’Arides, je me retrouve à la fois dans le père et le fils, celui qui subit et celui qui cherche à écrire quelque chose de nouveau.
Publier un roman, est-ce un rêve d’adolescent ?
Oui, j’ai toujours écrit (j’en ai fait ma carrière dans les médias) et depuis que je suis adolescent je rêve effectivement de publier un roman. Mais c’est un rêve que j’ai longtemps négligé, pris par d’autres «priorités» de la vie. Sans doute aussi ne le croyais-je pas atteignable, j’en avais peur. Et puis un jour, je me suis demandé ce que je voulais faire de la suite de ma vie, quelles étaient ces choses importantes que je voulais accomplir. Je me suis souvenu de ce rêve et j’ai constaté qu’il était intact en moi. Alors je m’y suis mis, j’ai commencé à écrire quelques lignes, quelques pages, de ce qui, des années plus tard, allait devenir Arides. J’osais regarder ce rêve en face, j’osais le considérer comme une chose essentielle, une part de mon identité que je ne pouvais plus nier ou laisser de côté.
Aujourd’hui, j’assume de donner toute la place que méritent mes rêves et je m’attelle à en concrétiser d’autres. Je suis dans l’écriture de mon second roman, et je compte ensuite travailler à l’écriture d’une adaptation d’Arides en scénario : je veux que ce livre devienne un jour un film! Je lance d’ailleurs un appel à celles et ceux - producteurs.trices, réalisateurs.trices, scénaristes… - dont c’est le métier et qui voudraient prendre part à ce rêve avec moi !
Voici le lien du podcast mentionné plus haut :
https://open.spotify.com/show/5YBnYFMASsEOYPqE0RKlgX?si=6e252ab7313f42d5&nd=1
© Entretien, photos, Denis Morin,
Mickaël Carlier, 2021